-
26 novembre 2024
Trump peut-il être utile?

L’affaire est entendue (entre nous, gens de bien), Donald Trump est un personnage répugnant qui poursuit des objectifs hautement malsains. Son mandat pourrait bien aboutir à des catastrophes, aussi bien pour les États-Unis que pour le reste du monde. Mais ses projets sont-ils tous mauvais? Ne peut-on pas entrevoir que son mandat aboutisse à quelques bonnes choses, au moins sur le plan économique? Voici quelques cas qui méritent, peut-être, d’échapper à un négativisme radical. lire la suite
-
18 novembre 2024
Indexation des retraites sur les prix: faut-il revoir les règles?

Un an après une réforme qui a surtout touché à l’âge de la retraite sans résorber l’intégralité des déficits, la question du niveau de ces retraites est revenue sur le devant de la scène, avec un débat sur les revalorisations. L’indexation sur les prix ayant montré ses limites, faut-il revenir à une indexation sur les salaires? Le moment est peut-être venu d’une réflexion plus large sur les limites de la référence aux prix, face à des perspectives économiques de moins en moins favorables. lire la suite
-
8 octobre 2024
Quelles pistes d’aménagement de la réforme des retraites?

Le Premier ministre Michel Barnier souhaite «améliorer» la réforme des retraites du printemps 2023, mais il serait irresponsable d’augmenter des dépenses de retraite déjà trop lourdes. Les assouplissements catégoriels (femmes, pénibilité) ont par ailleurs autant d’avantages que d’inconvénients, comme le montrent les conséquences des réformes passées. Une piste plus prometteuse serait de permettre des départs anticipés avec décote d’âge. lire la suite
-
24 septembre 2024
Et si le taux d’intérêt naturel était plus bas qu’on ne le pense?

De nombreux observateurs estiment qu’après la fin du cycle actuel de politique monétaire, les taux d'intérêt resteront nettement plus élevés qu'avant la pandémie. Mais différents signaux suggèrent l’inverse. Deux facteurs se combinent : une demande globale contrainte par le poids de la dette mondiale et une normalisation de la prime de risque, qui semble probable aujourd’hui. Il est donc possible qu’on revienne à l’environnement de taux d'intérêt bas qui régnait jusqu’au début 2020. lire la suite
-
23 septembre 2024
Comment éviter que le rapport Draghi ne serve à caler les armoires?

Le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne n’est pas particulièrement révolutionnaire, que ce soit dans son analyse ou dans ses propositions. Mais il a le mérite de poser avec clarté le défi industriel qui s’impose aujourd’hui à l’Europe. Comment se donner une chance de mettre en œuvre ses recommandations? lire la suite
-
11 septembre 2024
La politique économique de Michel Barnier

Que va pouvoir faire Michel Barnier à Matignon? En un mot, pas grand-chose sinon gérer les affaires, l’ère des réformes est bien terminée. La question est de savoir ce sur quoi le centre et la droite peuvent se mettre d’accord et ce que le RN va exiger. lire la suite
-
10 septembre 2024
Quelle réforme de la réforme des retraites?

Suspension ou pas, revenir sur la réforme des retraites amène à un arbitrage sur les trois paramètres bien connus: alourdir la cotisation des actifs, baisser dans le temps le niveau des prestations, allonger la durée d’activité pour une retraite à taux plein. Chacun de ces choix a son avantage budgétaire et son coût politique. Vers quel équilibre s'achemine-t-on? lire la suite
-
4 septembre 2024
Le programme économique du NFP est-il crédible?

Le programme économique du Nouveau Front Populaire, tel qu’annoncé durant la campagne législative, est-il chiffré, modéré et progressiste, ou au contraire fantaisiste, irréaliste et inapplicable? Et que penser du soutien appuyé dont il a bénéficié de la part de certains économistes de renom? lire la suite
-
25 juin 2024
Les risques économiques et financiers des programmes NFP et RN

Conçus sur la base de raisonnements économiques tronqués, voire faussés, les programmes du RN et du NFP semblent dater de plusieurs décennies. Ils présentent de grands risques pour l’économie française, à la fois sous la forme d’un affaiblissement de la capacité productive et d’une détérioration dramatique des conditions de crédit, pour l’État et plus encore pour les entreprises. Il résulterait de leur mise en œuvre un appauvrissement et une perte de pouvoir d’achat, ainsi qu’une mise sous la tutelle d’institutions internationales en contrepartie d’aides d’urgence pour éviter la foudre des marchés financiers. lire la suite
-
24 juin 2024
La fuite en avant dans le «toujours plus»

Le programme du nouveau Front de gauche consacre une culture d’opposition et de virginité politique, en liquidant l’acquis de la gauche de gouvernement. Il revient sur l’héritage de Pierre Beregovoy en matière de lutte contre l’inflation par la désindexation, couvre ses dépenses par de nouveaux impôts ou des recettes imaginaires en ignorant superbement leurs effets sur l’économie réelle et notamment les PME, et revient sur une politique de l’offre initiée sous François Hollande qui a permis de créer deux millions d’emplois nets en dix ans. lire la suite
-
25 avril 2024
Finances publiques: baisser les dépenses ou augmenter les taxes?

Dès l’annonce de la nécessité d’une consolidation, un débat s’est engagé sur le comment. Certains recommandent que cette consolidation soit engagée via la hausse de l’impôt, d’autres via la baisse des dépenses. Un élément fondamental de la comparaison entre ces deux stratégies de consolidation est leur effet comparé sur l’activité. Or sur ce point des travaux économiques ont bousculé des croyances anciennes. lire la suite
-
12 avril 2024
Pourquoi la dette publique ne va pas baisser

La dette revient sur le devant de la scène. Gabriel Attal a résolument pris les choses en main et mentionné un tour de ceinture supplémentaire de 20 milliards… soit bien moins que 1% du montant de la dette. Depuis, les esprits s’échauffent à l’Assemblée, à l’Élysée et dans les ministères, et les propositions fusent de partout. Ce qui transparaît est inquiétant. Pour le monde politique, le débat sur l’endettement de l’État est une occasion rêvée de recycler les habituelles marottes de chacun tout en ignorant les ordres de grandeur du problème bien tardivement découvert. lire la suite
-
8 avril 2024
Poids de la dette et perspectives fiscales: le cas de l’Italie

Après le pic de la pandémie, le ratio de dette publique sur PIB a fortement diminué en Italie, grâce à une forte croissance économique réelle et nominale. Quelques changements institutionnels ont encore réduit les inquiétudes quant à sa viabilité à moyen terme. Mais les hypothèques sur la croissance obligent à prendre la question très au sérieux. Quelles sont les options? lire la suite
-
20 février 2024
Simplifier, mission impossible?

Gabriel Attal puis Bruno Lemaire ont promis de s’attaquer au chantier de la simplification, comme d’autres avant eux. Pour avoir des résultats durables et significatifs, ils devront s'attaquer à trois problèmes. Tout d’abord, les actions efficaces prennent du temps et nécessitent plus d'un mandat politique pour passer de la prise de conscience aux solutions puis à leur implémentation. Ensuite, les acteurs de la puissance publique comme les Français appelés à juger de leur action mesurent mal le coût macroéconomique de la complexité. Enfin les démarches entreprises pour la réduire sont souvent mal conçues. lire la suite
-
9 février 2024
La crise agricole épingle la fausse route de la lutte contre le réchauffement climatique

C’est peut-être prétentieux de l’affirmer, mais il y a une règle immuable en démocratie : à trop secouer les principes économiques, les choix politiques finissent toujours mal. Ce peut être un échec coûteux, une remise en cause plus ou moins discrète, ou des conséquences électorales sévères. La crise agricole révèle les sérieuses dérives de la lutte contre le réchauffement climatique. lire la suite
-
18 janvier 2024
Un pacte d’instabilité?

Des semaines de discussions laborieuses conduite sous la présidence espagnole de l’Union européenne et reflétant les clivages habituels entre Etats «dépensiers» et «frugaux» ont abouti à un compromis sur la réforme du Pacte de stabilité et de croissance suspendu depuis 2020. Le règlement du Conseil, après avis du Parlement européen, doit entrer en vigueur en 2024. Quel jugement peut-on porter sur ce nouveau cadre budgétaire, qui constitue un enjeu crucial pour la bonne marche de l’Union économique et monétaire? lire la suite
-
16 janvier 2024
Fiscalité du capital: une singularité française confirmée

Année après année l’interrogation persiste et, comme le montre le dernier rapport de France Stratégie, la réponse ne varie guère: oui, depuis le tournant de l’économie de l’offre, la France fait des efforts pour rapprocher sa fiscalité du capital de celle de ses principaux concurrents et partenaires. Mais non, la différence subsiste et avec elle les questionnements sur l’attractivité française et les handicaps structurels à la croissance et à l’emploi. lire la suite
-
24 novembre 2023
Discipline budgétaire: une leçon allemande

Le 15 novembre dernier, la cour constitutionnelle allemande a interdit au gouvernement d’utiliser 60 milliards d’euros pour financer son programme de lutte contre le changement climatique. Cette somme était ce qui restait d’un fonds constitué en 2021 pour faire face à la pandémie. Le jugement pourrait aussi affecter quelque 200 milliards supplémentaires mis de côté pour aider à la reprise économique. Les 60 milliards représentent 1,4% du PIB, les 200 milliards 4,5%, ce n’est pas rien. Cette décision illustre la manière dont l’Allemagne est arrivée à contrôler sa dette publique. En creux, elle explique pourquoi la France n’y arrive pas. lire la suite
-
5 juillet 2023
Dette publique, banques centrales et inflation: c’est reparti comme en 40?

Depuis quelques années, le secteur financier et la dette publique sont largement financés par les banques centrales. Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour retrouver une monétisation des dettes aussi massive. Le parallèle entre les deux périodes est éclairant, car les conséquences de la monétisation des dettes ne se limitent pas à une inflation en puissance. lire la suite
-
22 juin 2023
Financer la transition climatique: retour sur le rapport Pisani-Mahfouz
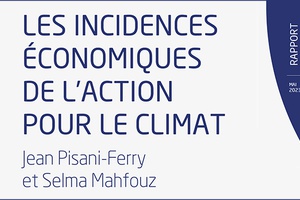
En rédigeant un rapport sur la transition climatique, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont fait œuvre utile. L’évaluation de la facture budgétaire en particulier est bienvenue. Mais leurs préconisations pour la financer sont discutables: le retour d’une fiscalité punitive pourrait nuire à l’effort de pédagogie qu’ils ont mené. Et n’a-t-on rien appris de ses effets contreproductifs? lire la suite
