Et si les Britanniques ne sortaient pas de l’UE? edit

Selon l’article 50 du traité de Lisbonne, le gouvernement britannique doit notifier au Conseil européen son intention de se retirer de l’UE. Il est le seul maître du calendrier et ne semble pas pressé d’accomplir cette démarche. Le Premier ministre David Cameron a annoncé son intention de démissionner de son poste en octobre et de laisser à son successeur le soin d’activer l’article 50. Du côté des autres membres de l’UE des voix discordantes se font entendre. Alors que du côté de Paris, de la Commission et du Parlement européen, on presse, la chancelière Angela Merkel veut prendre son temps. Les Britanniques saisiront-ils ce délai pour réviser leur décision?
Et si, at the end of the day, les Britanniques restaient dans l’Union européenne ? L’hypothèse la plus vraisemblable est qu’à la fin de longues négociations, ils obtiendront un statut particulier qui, moyennant quelques engagements de leur part, les feront bénéficier des principaux avantages du grand marché unique. Comme le disait plaisamment l’ancien député européen Jean-Louis Bourlanges, « les Anglais ont toujours eu un pied dedans un pied dehors, après le référendum se sera l’inverse ».
Mais on ne peut exclure le cas où, malgré le vote sans appel du 23 juin, le Royaume-Uni décide finalement de rester dans l’UE, avec les dérogations dont il bénéficie déjà actuellement. Plusieurs arguments militent pour cette possibilité, aussi incongrue puisse-t-elle paraître aujourd’hui.
Avant 2007, aucune procédure n’était prévue pour qu’un État-membre de l’UE quitte le club. Le traité de Lisbonne a introduit cette possibilité dans son article 50. Celui-ci prévoit que « l’État-membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen ». En l’occurrence il revient au gouvernement de Londres d’entreprendre la démarche. Au lendemain des 52% en faveur du Brexit, David Cameron a déclaré, en annonçant sa démission, qu’il laisserait ce soin à son successeur. Avant le vote, peut-être pour effrayer les tenants du Brexit, il avait pourtant déclaré que l’article 50 s’appliquerait immédiatement.
Le verdict tombé, chacun donne l’impression de vouloir gagner du temps. Le prochain leader du Parti conservateur qui sera aussi le prochain Premier ministre ne sera élu qu’en octobre au congrès ordinaire des Tories. Pendant ce temps, le Royaume-Uni reste un membre à part entière de l’UE, même si les vingt-sept chefs d’État et de gouvernement ont décidé de siéger sans lui lors du Conseil européen du 28 et du 29 juin. Et même s’il devrait renoncer à exercer la présidence tournante du Conseil des ministres qui lui revenait à partir du 1er juillet 2017.
Sur le calendrier, des voix discordantes se sont immédiatement fait entendre sur le continent. Certains, comme les Français, la Commission de Bruxelles et le Parlement européen, pressent les Britanniques de notifier aussi rapidement que possible leur intention de se retirer. En Allemagne, le ministre social-démocrate des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, est sur la même longueur d’ondes. Conformément à son tempérament, la chancelière Angela Merkel, elle, veut temporiser : « Honnêtement, ça ne peut pas durer une éternité mais je ne me battrai pas pour un court délai », a-t-elle déclaré. Tandis que son bras droit à la chancellerie, Peter Altmaier, avait une formule ambigüe : « Les dirigeants politiques londoniens devraient avoir la possibilité de réfléchir une fois encore aux conséquences d’une sortie [de l’UE]. » Réfléchir, pourquoi ?
Le référendum du 23 juin était officiellement « consultatif ». La décision formelle sur la sortie revient à la Chambre des communes. Les deux tiers des députés y sont opposés mais on voit mal comment ils pourraient aller à l’encontre d’un vote populaire. La pétition pour l’organisation d’un deuxième référendum, lancée avant même le scrutin par un partisan du « leave » inquiet du résultat possible, a recueilli plus de trois millions de voix en trois jours. La Chambre des communes est tenue de l’examiner mais pas d’y donner suite. Il y a donc fort peu de chances qu’une deuxième consultation ait lieu.
Cependant, le prochain Premier ministre pourrait considérer que n’ayant pas été soumis à une élection générale, il ne dispose pas d’une légitimité suffisante pour demander au Parlement majoritairement contre la sortie de l’UE de l’autoriser à activer l’article 50 du traité de Lisbonne. Il aurait alors tout loisir de dissoudre la Chambre des communes. Une façon de redonner la parole au peuple. Le thème dominant de la campagne pour les élections générales qui suivraient serait évidemment la question de l’Europe. Le scrutin aurait valeur de référendum. Si une majorité de députés était de nouveau en faveur du maintien, le futur Premier ministre pourrait en tirer argument pour ne pas enclencher le processus de divorce avec l’UE.
Même un chef de gouvernement nommé Boris Johnson, l’ancien maire de Londres, un des hérauts du « leave », qui n’en est pas à une volte-face opportuniste près, devrait y penser. Lui-même ne parait plus très pressé de tirer rapidement les conséquences du vote du 23 juin. Dans une tribune du Daily Telegraph, le journal conservateur dont il a été le correspondant bruxellois, il explique que Londres a le temps avant d’annoncer sa sortie, tout en en minimisant les conséquences : le Royaume-Uni profiterait toujours du libre-échange et serait toujours partie prenante du marché unique.
Le paysage politique britannique a été bouleversé par le résultat du référendum. Les deux grands partis sont divisés. David Cameron est démissionnaire mais le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, se trouve dans une situation guère plus enviable. Adversaire de toujours de l’Europe, il se voit reprocher par ses amis politiques une campagne trop tiède en faveur du « in ». Leader inattendu du Labour, ses jours à la tête du parti semblent comptés.
La fin des relations tourmentées entre Londres et l’Europe est loin d’être écrite. Le prochain chef du gouvernement, quel qu’il soit, y réfléchira sans doute à deux fois avant de franchir le pas. D’autant plus qu’il apparaîtrait comme le sauveur du Royaume-Uni en empêchant une sécession de l’Ecosse, qui semble décidée à choisir l’Europe contre l’Angleterre. La chef du gouvernement écossais a même agité la menace d’une opposition du Parlement écossais à majorité nationaliste et verte à la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Menace vaine sans doute parce que le Parlement écossais n’a pas ce pouvoir. Mais dans un pays où il n’existe pas de Constitution écrite, tout est question de rapports de force politiques… ou de coutume. En la matière, celle-ci n’est d’aucun secours pour départager les Écossais et les Anglais.
Cet article est publié en partenariat avec Boulevard Extérieur.
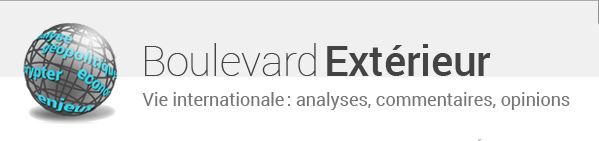
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

