Contre les écrans, pour les enfants edit
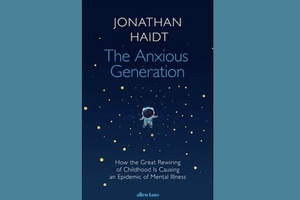
La surexposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux accompagne une montée de la dépression et de l’anxiété chez les jeunes. Dans un bréviaire très argumenté contre les écrans, un professeur américain de psychologie sociale propose ses observations et propositions.
Le constat de Jonathan Haidt est imparable : la santé mentale des jeunes se dégrade, singulièrement depuis l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux. « Nous avons mal alloué nos efforts protecteurs », pointe-t-il en développant une thèse à double entrée : les enfants sont aujourd’hui surprotégés physiquement face aux risques du monde réel ; ils sont sous-protégés mentalement face aux dangers du monde virtuel.
La situation est dramatique : privation de sommeil, addiction aux écrans, fragmentation de l’attention. La génération Z (née après 1995), est la première à vivre sa puberté dans un monde virtuel, derrière les écrans. « C’est un peu comme si cette génération était la première à grandir sur Mars », écrit Haidt. Les données, centrées sur le contexte américain, sont édifiantes : en 1991, 50% des collégiens et lycéens voyaient quotidiennement, en face à face, en dehors de l’école, leurs amis. Ils ne sont plus que 25% en 2017. Chez eux, la prévalence des épisodes dépressifs a été multipliée par 2,5 entre 2010 et 2020. Les gestes d’automutilation ont, sur la même période, crû de 200%. Élevés par des parents inquiets, ils prennent moins de risques. Ils ont moins de vraies relations amicales, moins de relations sentimentales et sexuelles. Ils passent moins rapidement le permis de conduire. Et ils passent la plupart de leur temps en ligne.
S’appuyant sur les sciences sociales, la neurologie et des maximes de sagesse antique, Haidt soutient qu’il n’y pas uniquement corrélation entre la montée de l’anxiété et de la dépression, d’un côté, et la généralisation des connexions virtuelles, de l’autre. Avec des arguments valables, il soutient que la causalité est forte.
Que faire ?
Haidt plaide d’abord pour que la surveillance et la supervision des parents se relâchent, dans le monde réel. « Les interactions physiques, face à face, tout comme les rituels en communauté, sont des activités humaines fondamentales, aux racines très anciennes. » Que les enfants jouent, se rencontrent et prennent des risques. Ils doivent apprendre à s’amuser ensemble, à se blesser, à s’ennuyer. Surtout, que les enfants lâchent leurs portables ! L’expert plaide ensuite pour de vastes changements en matière d’accès au numérique. Le smartphone devrait être interdit, par les parents, avant l’âge du lycée. Les réseaux sociaux ne devraient pas être permis avant 16 ans. Du côté des écoles, ces instruments devraient être systématiquement laissés dans les casiers, pendant les cours comme pendant les autres moments dans l’univers scolaire. Si Haidt pense qu’il s’agit de mesures de bon sens, entraînantes à condition que certains parents s’y mettent, ils estiment aussi que quelques législations plus contraignantes devraient peser sur les fournisseurs afin qu’ils vérifient sérieusement les âges de leurs utilisateurs.
Puisqu’il a du succès, l’ouvrage a ses détracteurs. Ceux-ci critiquent une méthodologie qui manque de nuance. Accusé également de technophobie et de ringardisme (puisque des craintes similaires ont été éveillées avec la télévision ou avec le walkman), Haidt marque cependant bien des points. Et ce ne sont ni le rapport sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, rendu à Emmanuel Macron fin avril, sous le titre proustien « À la recherche du temps perdu », ni le rapport de l’OCDE publié début mai, sous le titre plus prosaïque « Élèves et écrans : performance académique et bien-être », qui démentent ses conclusions et ses orientations. Au contraire.
Jonathan Haidt, The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness, New York, Penguin Press, 2024.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)


