Les externalités économiques des dépenses militaires edit
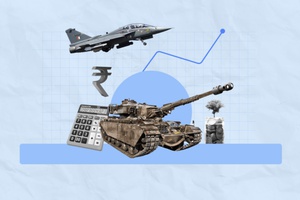
Face au regain de tensions géopolitiques provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le désengagement américain, les pays européens ont amorcé une hausse marquée de leurs budgets de défense. L’Allemagne a annoncé un accroissement de 100 milliards d’euros par an pour ses dépenses militaires, tandis qu’en France, le président Emmanuel Macron évoque la nécessité de « nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires ». Cette dynamique se heurte toutefois à de sérieuses contraintes financières dans un contexte de ralentissement économique global. L’Allemagne fait face à la double contrainte d’une énergie onéreuse pour son industrie et d’un environnement commercial mondial plus qu’incertain. Tandis que la France doit composer avec un déficit dépassant 6 % du PIB et une dette publique au-delà de 100 %. Dans ce contexte, la question des sources de financement des dépenses de défense et de leur efficacité économique est pertinente.
Sur ce sujet, plusieurs études académiques récentes se sont attachées à quantifier les impacts de ces dépenses. Elles soulignent que les dépenses militaires peuvent en effet avoir des effets positifs sur la croissance structurelle à long terme, notamment grâce aux retombées économiques des dépenses de recherche et développement (R&D) et aux commandes publiques qui leur sont associées. Une augmentation des dépenses publiques orientées vers ce type d’investissements pourrait donc s’avérer particulièrement rentable et donc trouver des financements plus aisément. Toutefois il serait précipité d’en conclure que seules les périodes de conflits et de fortes tensions internationales permettent ce type d’investissement. En réalité ce qui ressort de ces analyses c’est surtout que lorsque l’état s’investit massivement dans la mise en œuvre de projets ambitieux orientés autour d’une mission clairement définie et en faisant intervenir conjointement de nombreux acteurs économiques, les effets à long terme sur la productivité sont clairs et les bénéfices sont d’ailleurs encore plus importants hors périodes guerre.
À l’heure où l’Europe entreprend de se réarmer, cette note propose donc une discussion autour de d'estimations des effets concrets de ces dépenses. Elle rappelle aussi qu’une mobilisation similaire, dans un cadre non conflictuel, serait potentiellement plus fructueuse.
Les bénéfices économiques des dépenses militaires
Les anecdotes à propos d’innovations militaires qui ont trouvé des applications civiles ne manquent pas. Internet, le GPS ou encore les matériaux composites en sont des exemples emblématiques, tout comme de nombreuses innovations médicales et même dans une certaine mesure l’iPhone. Mais les défenseurs d’un État innovateur et interventionniste oublient trop souvent de mentionner la multitude de contre-exemples où l’État a poursuivi des cul-de-sac technologiques ou a étouffé l’innovation privée. Une analyse systématique et basées sur des données est nécessaire pour tirer des conclusions générales
Les économistes ont identifié trois mécanismes par lesquels l’investissement public (militaire ou pas) a des effets positifs sur l’économie en général.
Les externalités technologiques. Parmi ces mécanismes, les externalités technologiques se révèlent sans doute les plus déterminantes et peuvent s’appliquer à une multitude de secteurs. Les économistes considèrent en effet que plus de la moitié des bénéfices liés à l’investissement en R&D d’une entreprise profitent finalement à d’autres acteurs que le financeur initial. Les études les plus récentes soulignent ainsi qu’une entreprise investissant dans la R&D enregistre un retour annuel d’environ 30 % – un niveau qui ferait rêver la plupart des gestionnaires de portefeuilles –, tandis que la collectivité bénéficie d’un rendement deux fois plus élevé, grâce aux externalités dont chacun tire parti. En conséquence, qu’elle soit militaire ou civile, la R&D produit des retombées substantielles et diffuses : selon certaines estimations macroéconomiques, chaque euro investi dans la recherche militaire génère, à l’horizon de quinze ans, près de deux euros supplémentaires de PIB.
La productivité par les achats publics. Au-delà de ces avancées technologiques, les dépenses militaires impactent également la productivité des entreprises fournissant des armements à l’État. L’exemple le plus marquant reste la production d’avions de combat aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, après la défaite française, le président Franklin D. Roosevelt fixa un objectif jugé irréaliste par les économistes de l’époque : produire 50 000 avions militaires par an. Pourtant, dès cette même année, l’industrie américaine en construisit le double. Sous l’effet de cette commande hors norme, les constructeurs aéronautiques adoptèrent de meilleures méthodes de production, recoururent davantage à la sous-traitance et expérimentèrent des approches de gestion innovantes, ce qui renforça notamment la motivation et l’efficacité des salariés. Ce phénomène d’“apprentissage par nécessité” dépasse largement l’industrie de défense.
En période de guerre, et même après, les entreprises réagissent aux pénuries de ressources (humaines comme matérielles) en adaptant leurs capacités de production et en gagnant en efficience. Le secteur textile britannique en fournit un exemple historique lors de la guerre civile américaine : en raison de la rupture des exportations du sud des États-Unis, les entreprises commencent à exploiter de nouvelles fibres issues du coton indien. Cette même logique se manifesta durant les guerres napoléoniennes, quand la mobilisation d’une large partie de la main-d’œuvre britannique conduisit le secteur industriel à automatiser une partie de sa production. Enfin, après la Grande Guerre, le nombre élevé de jeunes hommes tués ou blessés en France hâta la mécanisation de l’agriculture afin de pallier le manque de main-d’œuvre.
La formation du capital humain. Le troisième mécanisme par lequel les dépenses militaires ont un impact sur l’économie civile est l’éducation. Le recrutement d’ingénieurs et de chercheurs dans les laboratoires militaires nourrit ensuite l’ensemble du tissu industriel. Historiquement, même l’éducation primaire et secondaire a bénéficié d’investissements accrus lors des périodes de tension militaire, ce qui s’est répercuté positivement sur le marché du travail.
En prenant tous ces mécanismes en compte, les études macroéconomiques suggèrent qu’à horizon de quinze ans, chaque euro investi dans la R&D militaire peut générer deux euros de PIB supplémentaire. De surcroît, dans le cas précis du réarmement européen, certaines estimations indiquent que le PIB pourrait croître de 0,9 à 1,5 % si les dépenses de défense sont portées à 2–3,5 % du PIB.
Des bénéfices encore plus grands en temps de paix
Les multiples exemples historiques et les évaluations macroéconomiques portant sur les dépenses militaires peuvent donner l’impression qu’un investissement massif dans la défense se traduit inévitablement par des effets durables sur l’innovation et, à terme, par une croissance soutenue. Cependant, ces résultats positifs découlent moins de la nature militaire des dépenses que d’une mobilisation d’envergure de l’État autour de grands projets technologiques, assortis d’objectifs clairs et réunissant entreprises, laboratoires, administrations, chercheurs et ingénieurs. En période de conflit, les gouvernements ont davantage tendance à prendre ces risques et à accélérer les financements, alors qu’ils y renoncent souvent en temps de paix. Les économistes parlent de « moonshots » pour qualifier ces grands paris, en référence à la course à l’espace pendant la Guerre Froide. Le tout premier « moonshot » – la mission Apollo de la NASA – a ainsi produit des retombées économiques considérables pendant près de trente ans, grâce notamment aux centres de recherche créés à cette occasion et à leurs découvertes persistantes bien au-delà de la fin du programme.
Avec la fin de la Guerre Froide, ces « moonshots » se sont raréfiés, et les États ont progressivement abandonné les grands projets d’innovation, affectant visiblement la croissance. D’après certaines estimations, le désengagement américain dans le financement de la recherche au cours des 60 dernières années expliquerait à lui seul un tiers du ralentissement de la croissance de la productivité, le moteur de l’amélioration du niveau de vie à long terme. La France a également réduit son soutien à la recherche en proportion du PIB depuis les années 1980, alimentant la crainte de voir disparaître un puissant moteur d’innovation sur le long terme. Pourtant, des investissements publics tout aussi massifs et coordonnés pourraient être entrepris en temps de paix, produisant alors des retombées au moins équivalentes, voire supérieures. Malheureusement, comme l’a montré la pandémie, nous avons en grande partie perdu la culture d’une politique d’innovation ambitieuse et cohérente.
Il est vrai que les financements consentis en temps de guerre atteignent des échelles rarement reproduites en période de paix. Le projet Manhattan, qui a abouti à la bombe nucléaire, représentait 1 % du PIB américain en 1945.[1] À titre de comparaison, le Projet du Génome Humain – vaste programme scientifique ayant permis le séquençage de l’ADN – n’a mobilisé que 0,1 % du PIB américain de l’époque, soit dix fois moins.[2] De son côté, le projet ITER, destiné à étudier la faisabilité de la fusion nucléaire, ne pèse qu’environ 0,2 % du budget de l’Union européenne (laquelle n’est pas la seule entité à le financer).[3] Or l’absence de ce type d’investissements massifs en R&D pendant les périodes de paix est d’autant plus regrettable que les taux de retour sur la recherche publique civile dépassent ceux de la R&D à finalité militaire. La science des blouses blanches est plus porteuse de progrès que la science des treillis kaki.
Recherche fondamentale et recherche appliquée
Les discours volontaristes qui émergent en France et en Allemagne pourraient certes marquer la fin de ce désengagement de l’État, mais il est dommage que cette prise de conscience intervienne exclusivement dans le cadre d’investissements militaires. Sans nier que de tels financements stimuleront probablement l’innovation, ils ne constituent pas la meilleure façon de soutenir le développement d’un pays ou d’améliorer sa solvabilité à long terme. En effet, l’innovation militaire relève davantage de l’application concrète que de la recherche fondamentale, si bien que lorsque des ressources publiques sont allouées à la R&D de défense, d’autres champs de recherche, notamment dans la recherche académique, se retrouvent délaissés. Cette situation peut paraître logique dans un contexte de guerre : il est plus urgent pour les Ukrainiens de se focaliser sur la mise au point de drones de combat que sur des travaux fondamentaux. Néanmoins, les répercussions de l’abandon partiel de la recherche fondamentale se font sentir sur le très long terme – souvent une vingtaine d’années – et s’avèrent particulièrement insidieuses.
De plus, la plupart des avancées technologiques majeures de la Seconde Guerre mondiale, telles que la maîtrise de l’énergie nucléaire ou la mise au point du radar, reposent déjà sur des découvertes scientifiques fondamentales qui précédèrent de plusieurs décennies le conflit. C’est donc en amont des guerres qu’il importe de développer la recherche fondamentale. Comme l’a souligné Georges Clémenceau, « la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique », et cette formule s’applique tout autant à l’innovation : l’innovation militaire est avant tout expédiente, pas nécessairement raffinée. Par ailleurs, les appels d’offres militaires lancés en période de guerre sont rarement source de retombées économiques aussi fortes que ceux conduits en temps de paix. Ces marchés sont en effet “fermés” : ils visent un objectif précis, comportent des spécifications strictes et suivent un cahier des charges rigoureux, limitant la liberté d’innover. Les appels d’offres “ouverts”, en revanche, encouragent la recherche de solutions originales, favorisent le dépôt de brevets et soutiennent la diffusion technologique. Contrairement aux modèles fermés, qui concentrent souvent les contrats entre quelques grandes entreprises, la mise en concurrence permet d’inclure des PME innovantes et d’accélérer ainsi les transferts de savoir-faire vers le secteur civil.
Des considérations spécifiques à la dépense militaire
Un déterminant capital de l’efficacité des dépenses et investissements militaires est le degré de concurrence entre les entreprises d’armement. Aux États-Unis, le ministère de la Défense a constaté que le nombre de sous-traitants d’armement a diminué de 86 dans les années 1980 à seulement 5 aujourd’hui (Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics). L’industrie militaire est caractérisée par des coûts fixes très élevés qui constituent des barrières importantes à l’entrée de nouveaux acteurs. Plus que dans tout autre secteur, elle tend donc à être dominée par un petit nombre d’entreprises très bien connectées au pouvoir politique, dotées d’une capacité de lobbying considérable.
Pour remédier à cette situation, une stratégie nécessaire consisterait à introduire davantage de concurrence, notamment en élargissant les appels d’offres au niveau européen. Cela implique de faire jouer pleinement la taille du marché unique européen, comme le recommande le rapport Draghi, en mettant en concurrence plusieurs fournisseurs pour chaque commande, tout en favorisant des standards communs afin d’augmenter les volumes. Regrouper les achats pour atteindre des cibles collectives permettrait de bénéficier d’économies d’échelle substantielles par rapport à des achats fragmentés par pays. Ce type de mutualisation réduirait sensiblement les coûts unitaires, tout en assurant une montée rapide en capacité de production. Des économies similaires sont envisageables dans les secteurs stratégiques de la guerre moderne, comme les drones. L’annonce par l’entreprise allemande Helsing d’une commande de 6 000 drones longue portée pour l’Ukraine en est une illustration concrète. Ce type de production en grande série pourrait offrir à l’Europe une parité quantitative et qualitative face aux capacités des autres régions.
En parallèle, il serait judicieux d’encourager les entreprises de défense à développer des produits à double usage civil et militaire, comme le font déjà certains groupes (Airbus, Thales). Cette diversification permettrait d’absorber plus facilement les fluctuations de la demande militaire et de renforcer la viabilité des industriels à long terme. En particulier, les capacités industrielles excédentaires dans certains secteurs (comme l’automobile) pourraient être rapidement mobilisées pour répondre à une hausse de la demande en équipements militaires.
Pour que cette stratégie porte ses fruits, les États membres devront néanmoins accepter de renoncer partiellement à une souveraineté nationale sur leurs investissements militaires. Cela soulève des questions politiques et stratégiques sensibles — comme celle de la gouvernance des envois d’armes à un pays tiers tel que l’Ukraine lorsque les investissements sont mutualisés. Ces arbitrages sont complexes, mais ils sont indispensables si l’on veut bâtir une base industrielle de défense européenne réellement efficace, compétitive, et capable de répondre aux défis actuels. Car, comme l'ont démontré de nombreux travaux, une politique industrielle n’est véritablement performante que lorsqu’elle s’appuie sur des mécanismes de marché et permet à la concurrence jouer pleinement son rôle.
Enfin, un dernier point à considérer est qu’il n’est pas forcément avisé de fixer des objectifs de dépenses militaires en termes de point de PIB, pour deux raisons principales. La première est que cela peut rendre les dépenses de défense cycliques, alors que les enjeux stratégiques qu’elle sert ne le sont pas (la Russie n’attaque pas nécessairement en temps de croissance économique…) et que l’innovation, militaire comme civile, a besoin de certitude et d’engagement sur le long terme pour produire des résultats. La seconde est que les objectifs chiffrés doivent être en termes de produits livrés et de qualité (par exemple : cinq Rafales capables d’apponter sur un porte-avions) plutôt qu’en termes de somme d’argent à dépenser. Un objectif fixé en termes d’euros à dépenser créera des motivations perverses qui forceront les administrations à dépenser de l’argent même si l’usage qu’il en est fait peut être gaspilleur.
Conclusion
Les dépenses militaires peuvent incontestablement dynamiser l’économie et accélérer la R&D, comme en témoignent nombre d’exemples historiques et des études empiriques récentes. Cependant, l’idée selon laquelle la guerre constituerait le meilleur moyen de stimuler l’innovation est trompeuse. Les effets bénéfiques des investissements de défense résultent moins du caractère militaire que de l’ampleur et de la coordination des efforts publics, mobilisant chercheurs, ingénieurs, laboratoires et entreprises autour d’objectifs ambitieux et clairement définis.
La situation actuelle, marquée par l’intensification des dépenses de défense en Europe, pourrait effectivement produire des retombées positives sur la productivité, la croissance et l’emploi. Il n’en demeure pas moins regrettable que ce sursaut ne se produise qu’en réaction à une crise sécuritaire. En temps de paix, des politiques d’innovation à grande échelle – portées par des programmes civils et fondamentaux – présenteraient un potentiel au moins équivalent, et sans doute supérieur, pour la prospérité de l’Europe.
En somme, réarmer l’Europe est justifié dans le contexte actuel, mais la véritable opportunité serait de renouer avec une politique d’innovation ambitieuse au service de la société civile. Si l’effort déployé pendant la guerre peut générer des innovations considérables, un engagement similaire, opéré sans la contrainte d’un conflit, pourrait avoir des effets encore plus profonds et durables.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Le PIB américain en 1945 était de 228 milliards de dollars (nominal), le coût total du projet Manhattan était de 2 milliards.
[2] Le PIB américain en 2003, à la fin du “Human Genome Project” était de 2 994 milliards de dollars. Le coût total du “Human Génome project” est estimé à 3 milliards de dollars.
[3] Le PIB de l’Union Européenne en 2024, en milliards de dollars (nominaux) est estimé à 28 000. L’estimation de budget la plus haute pour ITER est de 65 milliards de dollars.


