Kako Nubukpo et l’avenir de l’Afrique edit
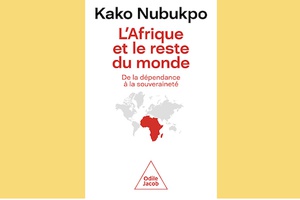
En 2030, un jeune sur deux rejoignant la force de travail mondiale (pour l’emploi ou le chômage) sera africain. Vous avez bien lu : un sur deux. Et pourtant, nous continuons à imaginer un monde de demain où tout se joue uniquement entre l’Amérique, la Chine, l’Europe, la Russie. Pour les dirigeants et les opinions publiques du Nord la vision du devenir africain ne semble exister qu’à travers trois filtres : les risques d’instabilité géopolitique, la crainte des migrations, les potentiels immenses en ressources naturelles. Au mieux, les nations africaines sont perçues comme une composante d’un « Sud global » en émergence. « Personne ne semble envisager que l’Afrique construise sa propre vision du monde », note l’homme politique et macroéconomiste togolais Kako Nubukpo dans un vigoureux et passionnant plaidoyer pour penser l’avenir du continent à partir de lui-même, en sortant de la « malédiction de l’extraversion »[1].
La population africaine était de 250 millions en 1950 (la moitié de la population européenne). Elle est de 1,5 milliard aujourd’hui (le double de l’Europe) et elle atteindra 3 milliards vers 2070. L’idée que le géant démographique du siècle puisse rester un nain économique est aberrante. Le livre de Kako Nubupko, prolongeant deux essais précédents[2], part de l’idée que les structures politiques et économiques actuelles, modelées par l’extraversion – les rentes d’exportation des matières premières n’en étant que la manifestation la plus frappante – seront totalement incapables de faire face au choc démographique. Des révisions radicales sont nécessaires.
L’auteur a été ministre de la prospective au Togo de 2013 à 2015. Il est aujourd’hui commissaire en charge de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine). Il s’est surtout fait connaître par son opposition résolue au franc CFA, qui selon lui n’incite absolument pas les Africains à investir dans l’économie réelle et les marchés intérieurs des divers pays. Dans ce nouveau livre, il rappelle d’abord que la croissance forte des PIB au cours des vingt dernières années est largement factice, car elle ne profite qu’à une petite minorité de la population et elle est essentiellement basée sur l’exportation des matières premières – avec des cours très volatils, qui plus est. Il se démarque ainsi d’un discours rassurant sur l’« émergence » africaine porté par nombre de ses collègues.
De fait, en matière d’émergence, les données sont plutôt sombres : le PIB par tête (en parité de pouvoir d‘achat) était en 1960 environ la moitié de la moyenne mondiale, il est aujourd’hui le quart. À la même date, l’Afrique était à peu près à parité avec les pays émergents d’Asie de l’Est, le PIB par tête de ces derniers est aujourd’hui 7 fois supérieur[3]. L’Afrique n’attire que 1% du capital privé mondial, et se trouve quasiment absente du monde manufacturier planétaire et de ses chaînes de valeur. Si on ajoute les effets particulièrement violents des crises écologiques, l’Afrique semble destinée à regrouper dans les décennies qui viennent la très grande majorité des populations en très grande précarité de la planète.
Pour expliquer cette situation, Kako Nubukpo reprend des analyses bien connues, comme la responsabilité des politiques d’ajustement structurel qui ont empêché, à un moment critique, d’investir dans les infrastructures sociales et techniques et bloqué le démarrage possible d’une industrialisation de transformation qui avait besoin de temps et de protections commerciales (le « protectionnisme éducateur » dont avait bénéficié par exemple d’Amérique latine).
Mais le livre ne se limite en rien à la déploration habituelle rejetant les responsabilités sur l’attitude prédatrices des anciennes puissances coloniales et la complicité d’une grande partie des dirigeants africains dans cette trajectoire. Il insiste sur la nécessité de changer de paradigme et de repenser l’avenir des économies africaines en les recentrant sur les besoins locaux et les marchés intérieurs, et en allant vers une véritable souveraineté, conçue par et pour les Africains eux-mêmes. Cela passera nécessairement, selon Kako Nubukpo, par des mesures de protection des marchés, thèse hétérodoxe (et discutée) qui va à rebours des idées dominantes prônant l’ouverture commerciale. À ses yeux, le paradoxe est que l‘Afrique jouera d’autant mieux le rôle mondial que justifient sa taille et sa démographie qu’elle cessera de se penser principalement par rapport à son extérieur.
Sur cette base, l’ouvrage aborde de multiples sujets. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte sérieusement les questions écologiques, trop souvent considérées comme une affaire de pays riches, dont on s’occupe une fois qu’un certain niveau de développement est atteint. La chance de l’Afrique est au contraire de pouvoir bâtir des trajectoires incluant dès le départ un nouveau rapport à la nature et au vivant, sans passer par les étapes qui nous ont conduit aux crises écologiques que nous connaissons. L’auteur parle aussi de la responsabilité particulière de l’Afrique au regard des biens publics mondiaux (par les grandes forêts notamment) et de la logique qui voudrait que le poids financier de leur préservation soit partagé avec le Nord.
La thèse essentielle du livre est que la priorité doit être donnée à l’agriculture et au sort des paysans modestes ou pauvres. L’agriculture africaine est totalement atypique. Occupant encore la moitié de la population active, malgré une forte urbanisation, elle arrive à nourrir le continent (les importations alimentaires restant assez limitées), mais avec des niveaux de productivité extrêmement bas, tant du point de vue du travail que du sol consommé[4] , faisant peser de grandes incertitudes sur le futur (maintien de l’autonomie alimentaire, préservation des espaces naturels et forestiers). L’auteur fait le pari que cette agriculture paysanne pourra évoluer, augmenter son niveau de productivité, sans passer par l’étape des « révolutions vertes » asiatiques, mais en appliquant les principes de l’agroécologie, de la « révolution doublement verte »[5]. Il y a sans doute un peu d’angélisme dans ce pari, mais pour Kako Nubukpo l’objectif premier doit être de privilégier les marchés intérieurs, l’organisation des filières, en maintenant un niveau d’emploi élevé. L’Afrique, selon lui, a les moyens de nourrir l’Afrique. Au passage, l’auteur dit sa réserve par rapport aux projets actuels de marchés communs inter-africains, qui ne devraient pas se bâtir trop vite, pour éviter les déstructurations locales et régionales. Pour que l’agriculture paysanne puisse survivre et prospérer, il faudra évidemment la protéger des importations venues d’agricultures globalisées considérablement plus productives, quitte à augmenter un peu la facture alimentaire des urbains.
Cette protection sera également nécessaire dans les domaines industriels, si l’on veut sortir du cercle vicieux actuel où l’Afrique exporte sans rien transformer ses matières premières, pour réimporter des produits fabriqués à bas prix en Chine ou ailleurs. L’Afrique, par exemple, ne transforme que 3 % du coton qu’elle produit, mais importe en masse des textiles asiatiques, y compris les produits en fin de vie des friperies du Nord. Sur cet enjeu industriel, Kako Nubukpo passe assez vite, contrairement à d’autres auteurs importants, comme Carlos Lopes[6]. Or c’est bien sûr un enjeu central, car sans secteur à haute productivité et à salaires (relativement) élevés, il est difficile d’augmenter la richesse moyenne. La situation africaine est singulière, puisque l’emploi qui se développe est essentiellement tertiaire, urbain, souvent informel et peu productif, comme si la case industrielle avait été sautée dans la trajectoire du développement. Mais comment penser cette industrialisation ? Certains pensent que l’Afrique devrait suivre la voie qui a si bien réussi aux économies émergentes d’Asie. Mais le contexte mondial est aujourd’hui très différent de celui qui a permis les « success stories » des tigres et dragons asiatiques, s’insérant dans les chaînes de valeur mondialisée grâce à trois conditions : leurs bas coûts de main d’œuvre, la possibilité d’accéder sans trop de difficultés aux technologies du Nord, et le fait que la faible demande intérieure pouvait être compensée par l’exportation. Or ces trois conditions ne sont plus réunies dans un monde où l’industrie est de plus en plus intensément capitalistique, où le coût de la main-d’œuvre n’est plus un facteur déterminant, où des compétences de plus en plus sophistiquées sont nécessaire et où la géographie productive se recentre à proximité des marchés solvables, dans les pays riches ou leur immédiate proximité[7]. Ceux qui imaginent encore que l’Afrique pourrait s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales selon un modèle de type Bangladesh et des « partenariats » Nord-Sud où l’Afrique apporterait surtout son faible coût du travail, se trompent d’époque. Cette fenêtre n’est plus ouverte, et c’est peut-être tant mieux. Là encore, l’Afrique devrait d’abord produire pour elle-même, avec des méthodes et des produits adaptées à sa propre situation, mobilisant la créativité de son immense jeunesse pour des formes « industrielles » réinventées. C’est un extraordinaire laboratoire en perspective, et un beau sujet – ainsi que d’autres, trop rapidement traités dans le livre : l’énergie, l’urbanisation – pour un tome quatre des réflexions de Kako Nubupko.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Kako Nubukpo, L’Afrique et le reste du monde. De la dépendance à la souveraineté, Odile Jacob, 2024
[2] Kako Nubukpo L’Urgence africaine. Changeons le modèle de croissance, Odile Jacob, 2019 ; Une solution pour l’Afrique. Du néo protectionnisme aux biens communs, Odile Jacob, 2022.
[3] Voir le dossier réuni dans The Economist, 11 janvier 2025, qui ne voit de salut que dans une « révolution capitaliste », pilotée par de nouvelles générations d’entrepreneurs.
[4] Contrairement à ce qui s’est passé dans le reste du monde, la croissance de la production alimentaire en Afrique s’est réalisée essentiellement, au cours des dernières décennies, par une extension des terres cultivées, et non par une augmentation des rendements à l’hectare. La part de terres irriguées, d’autre part, reste très faible.
[5] Sur ce point, on pourra relire les travaux pionniers de Michel Griffon, comme : Pour des agricultures écologiquement intensives, Éditions de l’Aube, 2010, et Nourrir la planète, pour une révolution doublement verte, Odile Jacob, 2006.
[6] Carlos Lopes a dirigé la Commission pour l’Afrique de l’ONU. Il défend la primauté de l’industrialisation, non pas en imitation de l’Occident, mais en inventant des voies propres, dans un livre également passionnant : C.L. L’Afrique est l’avenir du monde, Seuil, 2021 (préface d’Alain Supiot).
[7] Certains auteurs sont, de ce fait, sceptiques sur les possibilités de l’industrialisation africaine. Voir l’article de Dani Rodrik, « Growth without industrialization », Project Syndicate, 2017, dont je partage entièrement les conclusions.


