L’héritage politique de Victor Hugo edit
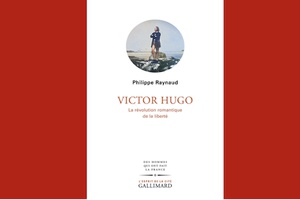
L’année 2024 a été une grande année Hugo. L’incendie de Notre-Dame en 2019 avait fait s’envoler les ventes de son roman Notre-Dame de Paris (1831) ; la mobilisation internationale pour sauver le monument en péril doit beaucoup à la gloire pérenne de Hugo. Le long métrage du studio Disney en 1996, Le Bossu de Notre-Dame, a drainé 22 millions de spectateurs européens et la comédie musicale Notre-Dame de Paris, créée en 1998 et adaptée en huit langues, a été représentée plus de 20 000 fois en vingt ans[1]. Les Misérables avait été fraîchement accueilli par les élites lors de sa publication en 1862. Lamartine jugeait le roman démagogue, Baudelaire le trouvait « immonde et inepte » mais le public populaire eut un avis tout autre. L’intérêt du grand public ne s’est jamais démenti ensuite : l’adaptation du roman en comédie musicale a fait le tour du monde (Paris 1980, Broadway 1987, Londres 1985, Paris 1991) et sa mise en scène au théâtre du Chatelet vient de remporter un nouveau triomphe en novembre 2024 - janvier 2025. Hugo est depuis un siècle et demi l’écrivain français le plus mondialement célèbre, et pour les Français il a la saveur des souvenirs d’enfance : qui de nous n’a récité « mon père, ce héros au sourire si doux[2] »…
Poète, romancier, il fait aussi partie de notre patrimoine politique commun, comme le souligne Philippe Raynaud, professeur de science politique, dans son ouvrage Victor Hugo, La révolution romantique de la liberté[3]. Le livre est publié dans la série « Des hommes qui ont fait la France » ; de fait, Hugo a « constamment joué sur des idées et des passions qui devaient finir par se fondre dans la synthèse républicaine de la fin du XIXe siècle ». D’où une interrogation sur ce qui subsiste de cet héritage chez nos contemporains. Hugo est certes immensément populaire, mais quel sens a pour nous aujourd’hui son humanitarisme, qu’on ne peut séparer de sa foi dans le progrès ? Que reste-t-il du lien qu’il avait établi entre le patriotisme, la justice internationale et une vision exaltée des États-Unis d’Europe ?
Hugo et l’héritage libéral dans la République
S’appuyant sur une lecture attentive des travaux remarquables des spécialistes de littérature, Philippe Raynaud cherche la singularité du « moment Hugo » et souligne d’abord ce que le jeune écrivain a dû aux libéraux. Il faut ici démolir une légende répandue par Hugo lui-même ; il se targue d’être né royaliste et devenu démocrate, parcours qu’il prétend original puisqu’il inverse le chemin qui mènerait – dit-on – naturellement tout un chacun, avec l’âge, de la gauche vers la droite (pur préjugé, à vrai dire, tant il y a d’exemples contraires ; Lamartine, Lamennais, Chateaubriand….). Hugo prétend avoir eu un père jacobin et une mère vendéenne. Mais son père avait commencé à servir sous l’Ancien Régime et combattu en Espagne sous Napoléon ; sa mère était issue d’une famille républicaine de Nantes et était devenue royaliste en 1812 parce que Napoléon avait fait fusiller son amant… Rien donc qui rattache le jeune Hugo à la chouannerie – du reste il ne fut pas baptisé ; il n’a nullement été pris dans le conflit entre les deux France, l’ancienne et la nouvelle, et il n’a pas eu à renier son enfance pour devenir démocrate. S’il commence sa carrière en poète de cour (il sera pensionné de Charles X), il se donne dès la préface de Cromwell en 1827 la mission de concilier le romantisme et le libéralisme. La bataille d’Hernani en 1830 approfondit cette « révolution romantique de la liberté » ; elle « remplace l’histoire du salut par celle des progrès de l’humanité, et substitue la fraternité à la charité pour en faire un principe de transformation de l’ordre social » (p. 21). Le jeune Hugo est un libéral modéré. Académicien en 1841 et pair de France en 1845, il fréquente la cour de Louis-Philippe et évolue vers la gauche de l’orléanisme par souci de lutter contre la peine de mort et contre la misère. Il ne reniera jamais cette inspiration libérale : député sous la Deuxième République, il se range avec réticence dans le parti conservateur jusqu’à juin 1849 ; il s’en éloigne lorsque l’armée française reçoit l’ordre de rétablir le pape à Rome contre les républicains. À la tribune il défend la liberté de la presse, est hostile au monocamérisme, adversaire résolu du socialisme (féroce à l’égard de Proudhon ou de Blanqui), opposé aux journées de juin parce qu’elles dressent le peuple contre la république – ce qui pour lui est un suicide collectif. Mais il est épouvanté par la brutalité de la répression. Ce libéralisme va faire partie de l’héritage républicain, celui de Jules Ferry notamment, et il a joué un rôle considérable dans l’histoire de la lutte contre la peine de mort, et plus largement dans le souci de la justice. Rien d’étonnant à ce que Robert Badinter se déclare hugolâtre et tire du roman Claude Gueux (1834) un livret d’opéra en 2013[4].
Le libéralisme de Hugo n’est pas cependant un libéralisme du juste milieu, surtout après 1851. Quatrevingt-treize, roman publié en 1874 mais commencé dès 1862, présente la révolution comme un bloc. Par là Hugo est proche de Clemenceau – et pas seulement de Ferry. La Terreur était la violence nécessaire pour détruire une résistance vendéenne passéiste dont Hugo reconnaît néanmoins la grandeur morale. Le jacobinisme a été un agent de progrès – le progrès a ses épilepsies, ce sont les soubresauts des guerres civiles. Mais l’œuvre révolutionnaire une fois accomplie, il faut se libérer de cet héritage jacobin. Philipe Raynaud note qu’il y a là quelque chose qui fait penser à l’opposition entre la première gauche et la deuxième qui croit, comme Hugo, qu’une société peut et doit atteindre à l’harmonie. L’évolution vers une gauche plus radicale mais dont il n’approuve pas la branche révolutionnaire caractérise la vie et l’œuvre de Hugo après 1851.
Hugo et la division des gauches
Hugo a d’abord soutenu Louis-Napoléon Bonaparte ; il a voté pour lui à l’élection présidentielle en décembre 1848 : il était sensible à la gloire du nom de Napoléon, il se sentait proche d’un prince qui avait cherché des remèdes au paupérisme – et il détestait Cavaignac qui avait réprimé le peuple de Paris en juin 1848. À l’Assemblée il s’était éloigné progressivement de la droite à partir de juin 1849. La rupture décisive est le coup d’État. Sans le 2 décembre 1851, Hugo n’aurait pas été le premier de nos grands littérateurs militants. Par son refus de tout compromis avec le césarisme (« et s’il n’en reste qu’un je serai celui là… ») il affirme son génie de pamphlétaire et atteint le sommet de sa production de romancier dans les Misérables.
Philippe Raynaud montre admirablement comment Hugo, devenu républicain de gauche, « a notablement contribué à exprimer des éléments fondamentaux du patriotisme républicain – ses principes mais aussi ses tensions ou ses apories ».
Tension d’abord entre le principe de nationalité et l’espoir des États-Unis d’Europe, entre le patriotisme républicain et l’internationalisme. Jusqu’au coup d’État, Hugo avait cru que la France serait à l’avant-garde du progrès de la liberté ; après le coup d’État il reporte sur l’Europe son espoir de progrès. Il « ne voit pas de contradiction insurmontable entre le principe national et l’unification progressive de l’Europe – et au-delà, de l’humanité, dès lors que cette unification se fait par la voie de la fédération et non par celle de l’empire » (p. 43). Dans la société des nations qui permettra d’éviter la guerre entre les États, les nations ne sont pas toutes égales aux yeux de Hugo – elles ne l’étaient pas davantage pour Guizot ou pour Michelet. Les États-Unis, quoique démocratiques, sont un pays de marchands d’esclaves ; la Russie est despotique ; le libéralisme économique anglais est dommageable aux pauvres. Reste l’Allemagne avec laquelle Hugo souhaite que la France contracte une alliance durable, quoiqu’il soit passé assez vite en 1870 du pacifisme à l’enthousiasme guerrier. Cette version hugolienne de l’internationalisme correspond, comme le souligne Philippe Raynaud (p. 47), à un projet répandu dans la gauche républicaine, repris par Jaurès et qui se prolonge dans la conception française d’une construction européenne bâtie autour du pilier fondamental du couple franco-allemand.
Tension ensuite à l’intérieur de la gauche selon qu’elle privilégie le recours à la réforme sociale ou à la révolution. La comédie musicale Les Misérables s’achève sur le triomphe des insurgés de 1832 ; le roman, lui, se termine mélancoliquement sur la mort de Jean Valjean. Pour Hugo la solution à la question sociale n’est ni dans l’émeute ni dans l’association version proudhonienne, ni dans le communisme pour lequel il a des mots très durs. Philippe Raynaud cite le discours du chef des insurgés, Enjolras, du haut de la barricade en 1832. Quoique nourri de Saint-Just, Enjolras peint le tableau utopique d’une république pacifiée : « Entendons-nous sur l’égalité ; car, si la liberté est le sommet, l’égalité est la base. L’égalité, citoyens, ce n’est pas toute la végétation à niveau, une société de grands brins d’herbe et de petits chênes ; un voisinage de jalousies s’entrechâtrant ; c’est, civilement, toutes les aptitudes ayant la même ouverture ; politiquement, tous les votes ayant le même poids ; religieusement, toutes les consciences ayant le même droit[5] . » 1789 est complété par 1848. Hugo, s’il a combattu pour l’amnistie des communards, ne fut pas un partisan de la commune pas plus qu’il n’avait approuvé les journées de juin 1848. Il comprend les raisons de la fureur populaire, s’émeut de la férocité de la répression, mais à ses yeux la guerre civile menace de tuer la république. « La commune est une bonne chose, mal faite », écrit-il ; comme le note Philippe Raynaud, on est là aux antipodes de Marx : pour Hugo la commune est une « figure avortée de la république démocratique » ; pour Marx elle est une forme de la dictature du prolétariat. Marx a eu plus de force de conviction dans l’historiographie socialiste que Hugo. Dans un violent pamphlet, La Légende de Victor Hugo, publié au moment de la panthéonisation de Hugo en 1885, Paul Lafargue note avec une joie mauvaise que « les révolutionnaires socialistes refusèrent de prendre part à la promenade carnavalesque » des funérailles…
Le livre de Philippe Raynaud s’achève par une réflexion sur la France d’aujourd’hui. La gloire de Hugo fait l’objet d’un consensus politique. Les républicains de la tradition de Ferry se retrouvent dans le Hugo modéré qui se bat pour le suffrage universel, l’instruction publique pour tous, le spiritualisme laïc. Les radicaux fils de Clemenceau partagent l’attention à la question sociale et le refus de condamner la Terreur. L’hugophobie de Lafarge ne fait plus recette depuis que le Parti communiste s’est présenté comme un parti de défense républicaine. La droite jadis hostile s’est ralliée à la république et ne se moque donc plus de la bêtise de Hugo, l’humanitarisme des droits de l’homme fait partie de la conscience commune. Mais est-il autre chose qu’une générosité convenue et de peu de conséquence ? L’engagement de Hugo pour le progrès tirait sa vigueur de la force de ses adversaires : il s’affrontait à un catholicisme figé et à un conservatisme aveugle à la question sociale. La conclusion de Philippe Raynaud est mélancolique : sans doute les grandes oeuvres littéraires peuvent-elles survivre aux circonstances politico-sociales qui firent leur succès.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Voir Maryvonne de Saint-Pulgent, La gloire de Notre-Dame. La foi et le pouvoir, Gallimard, 2023, p. 387.
[2] Voir La Gloire de Victor Hugo, catalogue RMN, 1992, sous la direction de Pierre Georgel.
[3] Philippe Raynaud, Victor Hugo. La révolution romantique de la liberté, Gallimard, coll. « L’esprit de la cité », 2024.
[4] Voir l’émission (en ligne) Robert Badinter et sa passion de Victor Hugo, Radio France, 12 juillet 2014.
[5] Cité p. 62. Les Misérables, tome V, livre 1.


