Calmann-Lévy et l’antitotalitarisme libéral edit
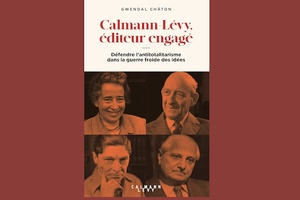
Si le concept et le terme de totalitarisme émergent à partir des années 1920, si au cours de la Deuxième Guerre mondiale différents outils intellectuels sont forgés pour appuyer le combat contre les fascismes européens et japonais, il faut attendre l’après-guerre pour que se développe pleinement une pensée antitotalitaire dont les grands noms sont Hannah Arendt, George Orwell, et en France Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Cornelius Castoriadis ou Claude Lefort.
Cette pensée fondamentalement plurielle a deux particularités majeures. La première est qu’elle se nourrit des faits, opposés aux aveuglements idéologiques ; mais que ces faits, s’agissant de régimes politiques opaques et lointains, sont eux-mêmes parcellaires, mal connus, difficiles à interpréter sereinement. Comme aujourd’hui face aux vagues de désinformation et de mésinformation, la vérité est elle-même un enjeu dans un combat contre des adversaires usant du silence, du mensonge, de la propagande. C’est pourquoi la fonction de témoignage est centrale dans cette nébuleuse intellectuelle qui s’engage activement dans un travail de recueil, d’écoute, de relais des voix étouffées, écrivains réduits au silence ou simples humains comme ceux évoqués par Camus dans son discours de réception du prix Nobel, le 10 décembre 1957 : « Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois, du moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l’art. »
La seconde particularité est que l’antitotalitarisme n’est pas tant une doctrine particulière, identifiable comme si souvent après-guerre à un coin du champ politique, qu’un travail de la conscience s’exerçant aussi bien à gauche qu’à droite et mettant à l’épreuve – celle des faits, de la morale, de la dignité humaine – des éléments constituants des croyances et discours politiques. La « deuxième gauche » française sera l’un de ces laboratoires critiques, après le choc de 1956 qui fait réfléchir la génération de Merleau-Ponty et mûrir celle de Castoriadis et Lefort. À droite, si des intellectuels catholiques comme Mauriac se rattachent à la nébuleuse antitotalitaire, la grande figure est indiscutablement Raymond Aron, qui incarne et anime l’antitotalitarisme libéral.
C’est une histoire intellectuelle de cet antitotalitarisme libéral français que donne Gwendal Châton dans son remarquable ouvrage Calmann-Lévy, éditeur engagé, sous-titré Défendre l’antitotalitarisme dans la guerre froide des idées[1]. Sa première qualité est d’articuler l’histoire d’un mouvement intellectuel et celle de la maison d’édition qui en a été le principal lieu d’accueil, sans négliger les aspects économiques qui sont inséparables de ses choix éditoriaux[2]. Avant l’arrivée d’Aron en 1947, il y a en effet un engagement fort de Robert Calmann-Lévy, avec la publication dès 1945 du Zéro et l’infini d’Arthur Koestler, rencontré à Londres pendant la guerre, et le rôle actif joué par Manès Sperber, qui continuera d’accueillir les livres de Koestler dans sa collection « Traduit de ».
La création en 1947 de la collection « Liberté de l’esprit » est une initiative de Robert Calmann-Lévy, mais le choix de la confier à Raymond Aron amène un élargissement des horizons intellectuels et politiques. Les débuts de la Guerre froide en 1948 auraient pu figer la ligne anticommuniste qui est au centre du projet initial. Mais la collection évite l’écueil d’un rétrécissement idéologique et accueille au contraire des figures étonnamment variées : on y croise ainsi des travaillistes anglais et des militants de la gauche antistalinienne comme Michel Collinet, aussi bien que des écrivains comme Salvador de Madariaga, conservateur antifranquiste qui est aussi un critique féroce du suffrage universel.
Le contexte de la Guerre froide, avec ses enjeux stratégiques brûlants et les menaces qui pèsent sur les démocraties d’Europe de l’Ouest, amène aussi des auteurs comme James Burnham, ancien trotskyste animé par un anticommunisme « qui oriente toute sa vision du monde » et se radicalise au fil des ouvrages : avec Suicide of the West, refusé par Aron, le « croisé de la guerre froide » a achevé de se convertir en « un apologiste de la réaction ».
La diversité des auteurs n’est pas qu’une manifestation de pluralisme. Elle atteste le caractère minoritaire et incertain d’un combat qui épouse les aléas de l’époque et requiert des alliances (ainsi l’implication active dans le Congrès pour la liberté de la culture fondé en 1950). Elle rappelle aussi l’évolution des champs considérés, de la philosophie politique à la théorie des organisations en passant par les relations internationales avec des auteurs de premier plan comme George Kennan.
Si le concept de totalitarisme est le fil rouge de la collection, Gwendal Châton note avec raison que cette catégorie est « faiblement théorisée ». Le marxisme, dont Aron lui-même est comme on sait un fin connaisseur, fait l’objet de divers ouvrages, tout comme l’idée de révolution. Mais la plupart de ces ouvrages sont des analyses de l’expérience soviétique et plus particulièrement du stalinisme. Il s’agit en somme de mettre au jour une réalité, de l’analyser et lever le voile de la propagande, plutôt que de proposer une construction théorique d’ensemble. Si cette attention au réel n’exclut pas des analyses très élaborées, la fonction documentaire est présente. Elle répond aux nécessités de l’époque, en lien avec les grands livres de témoignage (de Viktor Kravchenko à Alexandre Soljenitsyne). Elle va de pair avec la mise en évidence de mécanismes sociologiques (ainsi le développement d’une « classe directoriale »).
Gwendal Châton observe avec finesse comment, à partir des années 1950, la dimension critique et en quelque sorte négative fondée sur l’analyse des totalitarismes se double d’une interrogation sur l’identité intellectuelle de ceux qui portent cette critique. C’est dans ce contexte, avec une difficulté à se ranger dans les camps symétriques des socialistes et des conservateurs, que la référence à la liberté cesse progressivement d’être un simple barycentre pour devenir un cœur de doctrine, avec l’affirmation d’un « libéralisme ».
Ce mouvement restera inachevé, même si la revue Commentaire, portée par les héritiers d’Aron, a poussé plus avant la constitution doctrinale d’un libéralisme français, et que dans les années 1980 on a redécouvert les pères fondateurs, de Constant à Guizot en passant par Tocqueville ou Augustin Thierry. Mais telle qu’elle resurgit dans les années 1940 à 1960, telle qu’elle se développe ensuite, cette école de pensée reste fondamentalement marquée par une définition négative de la liberté (« ne pas être empêché d’agir »). Dans cette définition se lit l’ombre portée de l’antitotalitarisme, une configuration intellectuelle qui éloigne radicalement le libéralisme français de toute « grande architecture » philosophique, mais aussi de toute radicalisation idéologique. Dans sa version française, le libéralisme est davantage une inquiétude qu’une croyance.
De ce trait marquant du libéralisme français, qui signe sa différence avec d’autres écoles et notamment celles des penseurs autrichiens, l’histoire racontée par Gwendal Châton – celle d’une maison d’édition et d’un groupe d’auteurs qui ne sont d’accord, au fond, que sur l’essentiel – offre une remarquable clé de lecture. Marqué par ce laboratoire de pensée particulier qu’est la forme de la collection, le libéralisme aronien ne s’est jamais pétrifié en une idéologie. Il se distingue en cela de celui de Hayek, qui malgré son extraordinaire vigueur intellectuelle n’a pas échappé à une forme d’enfermement doctrinal. « Liberté de l’esprit » a ainsi vu naître une école de pensée qui a encore beaucoup à nous offrir, et dont l’histoire mérite d’être connue. Oui, cette histoire s’est nouée dans des circonstances particulières. Mais la passion mise par ces auteurs à comprendre ces circonstances, à déjouer les croyances et les propagandes qui masquaient la réalité, est une ressource intellectuelle qui répond aux exigences de notre époque.
Gwendal Châton, Calmann-Lévy, éditeur engagé. Défendre l’antitotalitarisme dans la guerre froide des idées, Calmann-Lévy, 2024, 290 p., 20,5 €.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Du même auteur, signalons une Introduction à Raymond Aron (La Découverte, coll. « Repères », 2023).
[2] Le succès du Zéro et l’infini, puis des livres de James Burnham confirme l’intérêt commercial de la ligne éditoriale et politique de la maison. Après 1953, l’équation se modifie : la rente tirée d’une négociation avantageuse avec le Livre de Poche assure pendant deux décennies la prospérité de la maison qui, note Gwendal Châton, n’a « plus vraiment besoin de publier des nouveautés pour vivre ». Ce qui facilite les choix et autorise des prises de risque.


