Marcel Gauchet face au nœud démocratique edit
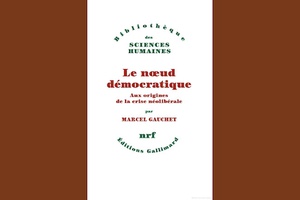
Ce dernier livre de Marcel Gauchet vient à la suite d’ouvrages antérieurs consacrés à une histoire conceptuelle de la démocratie et à ses crises[1]. Celui-ci se présente comme une synthèse qui entend éclairer la gravité de ce qui se joue actuellement, et qui n’est pas compris. Nous retrouvons le caractère des travaux de l’auteur, cette volonté de rendre compte des manifestations contradictoires de la réalité politique en construisant un système explicatif d’ensemble. Mais le prix à payer pour le lecteur est une certaine abstraction assumée, pour exprimer une pensée qui reprend, régulièrement, les propositions avancées pour donner toute leur complexité.
Toutefois, passées les difficultés et les afféteries du style, le propos peut se résumer relativement simplement. La réflexion de Marcel Gauchet part de ce qui a été l’intuition fondamentale de son œuvre, exprimée, dès 1985 dans Le Désenchantement du monde[2]. La sortie progressive des hommes de l’emprise de la religion a entraîné une structuration de nos sociétés qui ne se fonde plus sur un ordre hétéronome, s’imposant aux individus, mais sur une volonté d’autonomie de leur part. Ce mouvement historique, long et complexe, obéit à des tendances durables. Un équilibre a pu s’établir, tant bien que mal, avec les États Nations, qui ont composé les nécessités d’un ordre pour tous avec les droits et les libertés des individus. La grande crise des totalitarismes au XXe siècle, qui ont voulu absorber les sociétés dans un grand tout étatique, a pu être surmontée par l’accroissement des fonctions sociales des États après 1945. Mais, aujourd’hui, depuis le milieu des années 1970, nous sommes face à une crise d’une autre nature, plus lente, mais qui n’en est pas moins grave.
Les symptômes de cette crise sont connus : défiance généralisée vis-à-vis des pouvoirs, importance de l’abstentionnisme électoral, polarisation conflictuelle des opinions, montée des populismes, d’extrême droite surtout, mais aussi à l’extrême gauche. L’explication la plus courante est que ce sont là les effets de la mondialisation du capitalisme qui a fracturé les sociétés occidentales principalement, mais dont les conséquences s’étendent au monde entier. Pour Marcel Gauchet, cette explication prend l’effet pour la cause. Les ruptures des équilibres, dans nos sociétés, tiennent plus fondamentalement à la primauté acquise des droits individuels qui affaiblissent les pouvoirs politiques et font perdre de vue ce qui pourrait (et devrait) être un destin commun. Évidemment, le capitalisme mondialisé, avec la puissance de dérégulation qu’il porte, a sa consistance propre, mais il trouve ses conditions de possibilités dans l’extension sans fin des droits individuels aux dépens du politique.
Se constitue ainsi un régime nouveau, que l’auteur appelle du nom de « néolibéralisme », où par la puissance conjuguée de l’individualisme et du capitalisme les collectifs tendent à se dissoudre au profit des individus, et où les « élites » veulent accaparer un pouvoir qui ne laisse plus guère de place à l’expression des souverainetés populaires. Ce qui explique aisément que, pour lui, le clivage principal oppose désormais les « démocrates libéraux », qui trouvent dans la construction européenne à la fois une fin et un moyen pour établir une gouvernance d’un nouveau type, et les mouvements populistes, qui défendent les cadres nationaux où la souveraineté des peuples doit s’exercer et en appellent à des gouvernements forts, personnalisés, relativisant la place prise par l’État de droit. C’est le sens que Marcel Gauchet donne au titre de son livre, Le Noeud démocratique, un moment historique où les liens qui doivent s’instaurer entre les désirs d’émancipation individuelle et les exigences du « tout », pour avoir un destin commun, se distendent, voire peuvent se rompre. Même si la critique du nouveau « régime néolibéral » est centrale dans le livre, dans ses conclusions Marcel Gauchet se garde d’aller plus loin. Il en appelle, seulement, à la restauration d’un équilibre (à inventer...) entre les droits des individus et le politique. Tout juste suggère-t-il que le défi écologique peut être la cause qui permettrait de repenser ces rapports.
Le livre s’achève sur cette interrogation. Comme souvent dans les ouvrages de Marcel Gauchet, l’ampleur de la vision, qui embrasse la longue durée, est suggestive. Elle permet de relier ce qui peut apparaître comme un ensemble de contradictions. Mais est-elle juste ? J’y vois, pour ma part, deux sortes de difficultés. La première est ancienne. L’auteur postule (car il n’y a guère de démonstration) que la sortie de la religion concerne le monde entier. L’islamisme et les autres fondamentalismes religieux seraient même un contre-coup à ce phénomène porté par l’Occident. Mais cela n’est pas démontré. La prégnance de la revendication individualiste n’a pas du tout la même intensité selon les civilisations que la mondialisation économique n’efface pas. Pour ne prendre qu’un exemple, l’Inde et la Chine, qui représentent une bonne part de l’humanité, ne relèvent pas de l’analyse que l’on peut faire des sociétés européennes. Une seconde difficulté tient à la volonté de différencier nettement les mouvements totalitaires de XXIe siècle des populismes actuels. Certes, ils ne brandissent pas l’arme de la violence et progressent par les urnes (encore que l’assaut du Capitole aux États-Unis et la tentative de coup d’État au Brésil après l’élection de Lula montrent que cela n’est pas si simple). Mais leur caractère autoritaire est patent. Et, partout, quand ils le peuvent, c’est l’État de droit, et non seulement les droits individuels, donc la possibilité de contrôler le pouvoir, qui sont en cause. La qualification de « démocratiques » en parlant de ces mouvements est problématique. Une « démocratie illibérale » est-t-elle une démocratie ? Je ne crois pas. Et on aimerait que la capacité critique de Marcel Gauchet s’exerce, également, sur ce point fondamental. Son application proclamée à la recherche de nouveaux équilibres en serait davantage convaincante. C’est dire, autrement, qu’il y a là un autre nœud pour le débat.
Marcel Gauchet, Le Nœud démocratique. Aux origines de la crise néolibérale, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2024, 250 pages, 20 euros.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Marcel Gauchet, L’Avènement de la Démocratie I. La Révolution moderne, Gallimard. 2007 ; II. La crise du libéralisme, Gallimard 2007 ; III. À l’épreuve des totalitarismes, Gallimard, 2010 ; IV. Le nouveau monde, Gallimard, 2017.
[2] Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde, Gallimard, 1985.


