L’État, l’entrepreneur et le marché edit
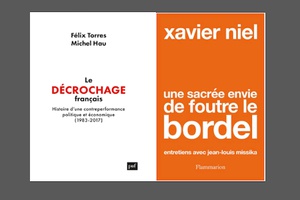
La place particulière de la décision publique dans l’économie française a une très longue histoire, dont on n’a pas fini d’explorer les rebondissements et qui, en dépit des idées reçues, n’est jamais univoque. Sans remonter jusqu’à Colbert, la Nouvelle histoire économique du Consulat et de l'Empire publiée récemment sous la direction de Thierry Lentz[1] montre ainsi les contrastes, sous Bonaparte, d’une politique économique ayant joué de tous les registres, « de l’interventionnisme présupposé au libéralisme revendiqué ».
Des contrastes similaires se rencontrent dans les dernières décennies et ils ne se réduisent pas, loin s’en faut, au jeu des alternances politiques. C’était l’un des enseignements du Virage manqué, le livre d’histoire économique consacré à la séquence 1974-1984 par Michel Hau et Félix Torres[2], recensé il y a trois ans dans la Bibliothèque de Telos. Il n’y a pas, ainsi, une gauche dirigiste à laquelle on pourrait opposer une droite libérale, mais une droite et une gauche cultivant l’une comme l’autre un goût marqué pour l’intervention dans les affaires économiques, tout en donnant assez d’air aux forces du marché pour que celles-ci animent la transformation de l’économie française. Mais elles le font en suivant leurs lois propres – qui n’obéissent guère à la volonté des politiques.
Cette désobéissance des forces du marché est un phénomène fascinant, et il y a là une façon originale de considérer notre histoire politique et économique récente. Deux ouvrages parus ces derniers mois offrent sur cette histoire des perspectives très différentes, mais qui se recoupent. Le premier est la suite du livre de Michel Hau et Félix Torres, couvrant la période 1983-2017[3]. Le second, ce sont les entretiens de Xavier Niel avec Jean-Louis Missika[4].
Chronique d’un décrochage
Félix Torres et Michel Hau ont intitulé leur nouvel opus Le Décrochage français, et le sous-titre est encore plus clair : c’est d’une contreperformance politique et économique qu’ils entreprennent d’écrire l’histoire. Leur premier volume pointait la remarquable et regrettable continuité, depuis 1974, d’une politique de la demande qui signait la différence entre la France et ses voisins, et l’analyse des conséquences de cette orientation reste l’un des fils directeurs de leur nouvel ouvrage. Le choix persistant du « keynésianisme dans un seul pays » a eu un effet délétère sur l’économie française. Le soutien à la demande sous ses diverses formes (soutien au pouvoir d’achat et redistribution, mais aussi politiques sociales et familiales, voire territoriales) a été financé en grande partie en piochant dans les comptes d’exploitation des entreprises ; il a pesé sensiblement sur l’appareil productif, en obérant sa capacité à investir et donc à prendre des positions fortes, soit en devenant plus compétitif sur les marchés existants, soit en innovant et en explorant de nouveaux marchés. Or, dans une économie ouverte, un affaiblissement de l’appareil productif se paie au prix fort. « L’entreprise tricolore court avec des semelles de plomb », notent les auteurs, qui insistent sur le problème chronique de compétitivité affectant le site France.
Les très grandes entreprises s’en sont sorties en choisissant de plus en plus de produire sur leurs sites étrangers (dans des proportions inégalées au regard de leurs homologues européennes : les entreprises du CAC40 réalisent à l’étranger 70 à 80% de leurs excédents bruts d’exploitation). Les petites et moyennes qui n’avaient pas ces possibilités ont peiné à croître, ou à encaisser les divers chocs économiques qui ont marqué la période. Désindustrialisation (dès les années 1980) et déficit du commerce extérieur (surtout sensible après 2001) sont ainsi « les deux faces d’une même contreperformance ».
L’État, pour autant, n’a cessé de s’inquiéter de l’industrie, et il a mobilisé des investissements. D’une main il dégradait la compétitivité des entreprises avec ses ponctions fiscales et sociales ; de l’autre il distribuait des subsides ou investissait. Mais cet interventionnisme a retardé la transformation économique, en consommant des fonds qui auraient été plus utiles ailleurs. Il ne s’agit pas ici des seules subventions aux bassins industriels sinistrés par la crise des mines et de la sidérurgie, mais aussi des politiques de « champions nationaux » qui ont perduré jusque dans les années 1990 et au-delà. Félix Torres et Michel Hau sont sans pitié, dans leur ouvrage, avec « les mécomptes d’une politique industrielle sacrifiant les secteurs d’avenir ». Ils brocardent aussi des politiques de l’emploi qui, aussi bien dans leur version territoriale avec les politiques de reconversion que dans leur version macro avec les 35 heures, ont contribué à atrophier l’offre de travail disponible – un comble au pays du chômage de masse ! Il faut attendre 2002 pour que le choix d’abord timide d’entrer dans une politique de l’offre finisse par s’imposer, lentement et non sans difficulté.
Truffé de détails et nourri de lectures approfondies, le livre de Félix Torres et Michel Hau montre avec précision comment un enchevêtrement de politiques mal conçues a eu pour effet un décrochage spectaculaire. L’économie a certes répondu aux multiples stimulations, injonctions et réglementations qu’édictaient ces politiques. Mais elle l’a fait en suivant ses propres lois, et non les intentions du législateur. Les élites politiques sont restées engoncées dans une matrice keynésienne, alors que la France et le monde entraient dans un régime doublement différent : les lois ricardiennes de l’économie ouverte, où la compétitivité et les avantages comparatifs décident du destin des nations, et les lois schumpetériennes de la croissance par l’innovation, avec une accélération du progrès technologique. L’État et à sa tête les politiques ont oublié Ricardo et tenté de retenir Schumpeter. Nous payons aujourd’hui le prix de cette ignorance.
L’évangile selon Xavier
Il y a quelque ironie à ce que Xavier Niel, une des rares réussites de cette déconfiture collective, se définisse justement par son ignorance — celle d’un homme qui n’a pas fait d’études et qui, par ailleurs, n’a rien d’un génie : « J’ai deux forces, qui sont basées sur mon absence d’intelligence : la simplification des problèmes, et la naïveté. Je simplifie les problèmes parce que je suis incapable de comprendre un problème complexe. »
Dans le monde de Schumpeter où nous vivons désormais, l’entrepreneur est la figure décisive : c’est lui qui incarne la part la plus vive du développement économique, en animant le mouvement de « destruction créatrice » qui voit des entreprises innovantes laisser les autres derrière elles. Les entretiens de Xavier Niel avec Jean-Louis Missika offrent une excellente opportunité de comprendre comment pense un entrepreneur.
Ce qui frappe à première lecture, c’est d’abord à quel point il évolue dans un monde ouvert : un monde qui ne se définit jamais par la clôture, mais toujours par la brèche. Xavier Niel lui-même y voit une sorte de biais d’optimisme, qui lui a d’ailleurs valu quelques déconvenues. Il n’évoque pas, comme le feraient un banquier ou un investisseur financier, une prise de risque, mais « des secteurs où personne ne va ». Niel l’entrepreneur est quelqu’un qui saisit l’ouverture d’une situation, quand d’autres acteurs, ou observateurs, ne se la représentent pas. En témoigne une conversation avec François Hollande à qui il présente le projet d’incubateur géant de Station F : « Mais vous êtes sûr qu’il y a mille startups en France ? » s’inquiète le président. Or « à l’époque, je ne m’étais jamais posé la question ! Pourtant c’est une question logique, j’aurais dû y penser, faire une étude de marché. » Mais c’est le désir d’explorer le possible qui l’a emporté.
Un autre trait marquant est la capacité à franchir des lignes. La matrice de cette capacité, chez Niel comme chez bien d’autres entrepreneurs de cette première génération du numérique, est la pratique du piratage quand il était adolescent. Cette pratique qui n’est pas encore illégale alors parce que la loi n’a pas encore été écrite, il la décrit comme un « jeu », et revient sur cette image à l’autre bout de son parcours : « Le jeu quotidien, pays par pays, dans les télécoms, là oui, ça me branche. » Gagner ? Jouer, surtout : l’économie comme un terrain de jeu, et l’entreprise comme art de s’inviter chez les autres, de s’insérer dans leurs systèmes, dans leurs marchés, de comprendre, déjouer et parfois récrire les règles du jeu. De l’adolescent au milliardaire, on repère la même approche ludique : Niel aujourd’hui encore s’aventure régulièrement dans les catacombes de Paris, explore leurs labyrinthes, exactement comme le bidouilleur de 15 ans se hasardait au cœur des systèmes d’information. La connexion et les possibilités du numériques effacent les frontières et abaissent les barrières. Dans sa prime jeunesse, c’est la séparation entre le légal et l’illégal qui est brouillée, mais la capacité à franchir les lignes est une qualité essentielle du futur entrepreneur. Elle lui permet de se déplacer d’un monde à l’autre, sans grande considération pour les barrières qui les bornent.
Dans le piratage Xavier Niel insiste aussi sur la dimension de communauté. Entre la notion plus tardive d’écosystème, centrale dans l’économie d’aujourd’hui, et le « groupe de gamins » qui vend en douce des disquettes et des décodeurs Canal+, il y a une certaine façon de jouer en solo tout en fonctionnant en réseau. Le monde nouveau de la connexion, du bidouillage et du bricolage amène aussi un passage fluide du petit groupe social à une activité économique, et de l’économie informelle au vrai business : petits trafics d’abord, puis création de services Minitel.
C’est ici que germe « une idée qui va faire ma différence et ma fortune ». Plutôt que d’acheter de gros ordinateurs à 1 ou 2 millions de francs, « je me dis que le PC que j’ai à la maison peut peut-être accomplir la même tâche ». Avec à la clé des heures ingrates à programmer, mais des coûts extrêmement réduits. « Tous ceux qui, comme moi, ont choisi cette solution, vont prendre le contrôle du marché, parce qu’on produit moins cher et mieux. » La compétitivité, cette grande absente des politiques économiques de l’époque, est au cœur de la machine Niel. Et dans ce monde d’industries naissantes, elle permet non pas seulement de battre les concurrents, mais de rafler la mise.
Cette compétitivité, chez Xavier Niel, est indissociable d’un art du contrepied : l’entrepreneur adopte systématiquement des façons de faire différentes, et généralement moins onéreuses, que ses concurrents directs. Son arrivée dans la téléphonie, en 1999, se joue quasiment dans les mêmes termes : là où France Télécom est encastré dans un système de briques industrielles piloté depuis les ministères et dont la clé de voûte est Alcatel, Free ira acheter des équipements moins chers ailleurs.
L’entrepreneur n’est pas obsédé par ses bases arrière, il ne se laisse pas entraver par le poids de l’existant. Dès le départ, il cherche systématiquement à entrer sur des marchés, certains à peine émergents comme « l’hébergement low cost de services Minitel ». Et quand l’aventure du Minitel s’achève il a depuis longtemps investi de nouveaux terrains de jeu. Là encore, il fait, en petit, exactement l’inverse de ce que fait l’État occupé à jouer les brancardiers pour les industries vieillissantes et les entreprises moribondes opérant sur de vieux marchés. Ce qui ne l’empêche pas de saisir des opportunités dans les mondes plus anciens contigus à ceux où il opère : ainsi des services de Minitel rose aux sex-shops.
Xavier Niel devient très vite un entrepreneur du monde physique. Il mobilise certes le potentiel du numérique et certains de ses concepts-clés (scalabilité, développement agile, usages, bouquet de services, forfaitisation…), mais ce n’est pas dans le monde évanescent des purs services numériques qu’il s’insère, mais dans celui de l’industrie. De la Freebox au développement d’un vaste parc d’antennes-relais pour la téléphonie mobile, ses entreprises s’appuient sur des produits qui consomment des matériaux, de l’ingénierie, et immobilisent des investissements.
Les marchés qu’il explore ne sont pas non plus des espaces sui generis. C’est à l’intérieur d’un secteur créé par la volonté politique que le jeune entrepreneur fait ses gammes, puis sa fortune. Et son incursion dans la téléphonie fixe, par la suite, n’est possible que grâce à la politique d’ouverture à la concurrence menée à l’initiative de la Commission européenne et appliquée en France. Xavier Niel intervient dans des espaces créés par le politique. Mais c’est en entrepreneur qu’il s’y fait une place : non pas en souscrivant à leurs représentations, comme au beau temps des politiques industrielles décidées dans les ministères, mais en développant ses solutions et en allant à l’occasion contre la volonté de l’État. Ainsi en 2007 et 2009 l’autorité de régulation des Télécoms ne croit-elle pas à la possibilité d’avoir quatre opérateurs de téléphonie mobile, et « les conditions d’attribution [de la licence] sont si peu avantageuses que personne ne veut y aller ». Iliad, seule en lice, gagne l’appel d’offre, et développe rapidement un modèle rentable. Là encore, c’est l’imaginaire du monde ouvert qui l’emportera contre celui du monde fermé qui est celui de la décision publique.
La vista de Niel, sa « chance » comme il le dit, sont avant tout une disposition d’esprit : une capacité à se représenter la réalité économique, à saisir les vraies règles du jeu, à décider d’y aller, au rebours de ce que font les autres ou de ce qu’attend le décideur politique. Cette trajectoire entrepreneuriale menée dans un pur esprit schumpetérien et au diapason des lois du marché contraste vivement avec des politiques économiques empêtrées dans les anciennes représentations. Plus encore, elle les déjoue. L’État croit maîtriser le jeu ? L’entrepreneur explore les espaces de liberté ouverts dans le système, s’y aventure, trouve des raccourcis et bidouille ses solutions.
L’ironie de l’histoire, et Xavier Niel ne se prive pas de la relever, c’est que son arrivée sur le marché de la téléphonie fixe puis mobile a fini par avoir les effets vainement espérés des politiques de « soutien au pouvoir d’achat ». Et dans un esprit bien différent des approches keynésiennes de relance par la demande. « Je suis schumpetérien, dit Niel. Je crois à la destruction créatrice. Pour créer de la valeur, il faut détruire les rentes. »
La boucle est bouclée avec le livre de Félix Torres et Michel Hau : l’économie peut contribuer au bien commun, mais elle déjoue constamment les attentes des politiques car elle obéit d’abord à ses propres règles. En bafouant ces règles, la politique abîme l’économie et manque ses objectifs.
Vous avez apprécié cet article ?
Soutenez Telos en faisant un don
(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)
[1] Thierry Lentz (dir.), Nouvelle histoire économique du Consulat et de l'Empire, Passé composés, 2024.
[2] Michel Hau et Félix Torrès, Le Virage manqué. 1974-1984 : ces dix années où la France a décroché, Manitoba/Les Belles Lettres, 2020.
[3] Félix Torres et Michel Hau, Le Décrochage français. Histoire d’une contreperformance politique et économique (1983-2017), PUF, 2024.
[4] Xavier Niel, Une sacrée envie de foutre le bordel. Entretiens avec Jean-Louis Missika, Flammarion, 2024.


